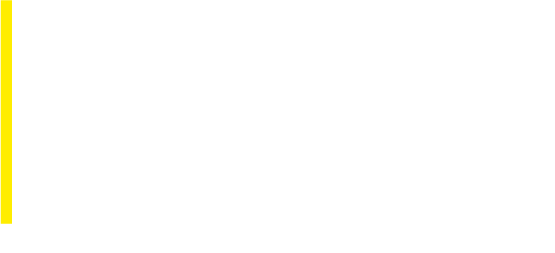CHARLES PÉPIN, AGRÉGÉ DE PHILOSOPHIE – QU’IL ENSEIGNE AU LYCÉE D’ETAT DE LA LÉGION D’HONNEUR À SAINT-DENIS –, DIPLÔMÉ DE SCIENCES PO ET D’HEC, MULTIPLIE AVEC BONHEUR LES MANIÈRES DE PHILOSOPHER. ON PEUT AINSI ALLER L’ÉCOUTER ET DIALOGUER AVEC LUI CHAQUE LUNDI AU MK2 HAUTEFEUILLE DE PARIS, SE PLONGER DANS SES ESSAIS TRADUITS DANS UNE VINGTAINE DE PAYS, OU BIEN ENCORE LIRE SES ROMANS. DANS LA JOIE, INSPIRÉ DE L’ÉTRANGER DE CAMUS, IL A SU, EN FAISANT OEUVRE DE DÉMIURGE, DONNER VIE AU MONDE DES IDÉES ET PLUS PARTICULIÈREMENT INTERROGER NOTRE TEMPS SUR SON RAPPORT AU BONHEUR.
Vos différentes activités de professeur, essayiste, romancier, ou encore conférencier, semblent indiquer une volonté de rendre la philosophie accessible au plus grand nombre. Peut-on parler de vulgarisation ?
Non, je ne définis pas vraiment mon travail comme une entreprise de vulgarisation. Je pense qu’il y a une ligne de partage entre le fait d’avoir ou pas quelque chose à dire. Il s’agit de proposer un « contenu substantiel », pour reprendre l’expression d’Hegel. Or, il y a des auteurs qui jargonnent de manière très savante mais dont le propos est dépourvu de substance, et d’autres qui a contrario développent un contenu substantiel très dense dans des termes accessibles. Certains textes d’Alain ou de Bergson offrent ainsi une apparence de simplicité, mais sont en réalité très puissants ; alors qu’à l’inverse certains universitaires dégagent une impression de force qui ne se vérifie pas. Cela n’empêche pas bien sûr qu’il peut aussi très bien exister des gens qui ne disent rien dans des termes fort simples, tandis que d’autres disent beaucoup de choses de façon complexe… Mais la frontière est bien là selon moi.
Vous considérez bien que la philosophie doit aider à vivre, qu’elle doit être une sagesse et non seulement un système spéculatif ?
Je milite en effet pour une philosophie qui ait des conséquences existentielles, qui perpétue l’esprit de la philosophie grecque, c’est-àdire aspirant à être un mode de vie tout autant qu’une spéculation théorique. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de spéculation abstraite, mais celle-ci vise à être réconciliée avec le quotidien, la vie pratique, les vertus morales, le rapport à autrui. Donc oui, je suis pour que la modernité renoue avec une philosophie existentielle, perdue au Moyen âge et à la Renaissance qui ont développé une mathématisation de la philosophie, devenue très algébrique. Elle s’est retrouvée au XXe siècle, avec Sartre notamment, qui a représenté un tournant important, tout en restant un monstre théorique, mais en revenant en même temps à l’existence.
Le nom de Pierre Hadot est de ceux qui reviennent souvent chez les partisans d’un renouveau de la philosophie existentielle, telle que pratiquée par les Anciens… Fut-il une influence pour vous ?
Il constitue en effet un de mes points de basculement. En le lisant, j’ai compris ce que j’avais ressenti sans tout à fait me l’expliquer, à savoir que ce qui m’intéressait dans la philosophie était justement qu’elle puisse être un mode de vie. Je respecte aussi ceux qui voient la philosophie autrement. Enfin, je les tolère plutôt… On voit tellement de penseurs qui ne savent pas vivre tout en se réclamant de la philosophie, scindés entre leur quotidien et ce que la philosophie les invite à vivre! C’est un spectacle un peu attristant en vérité.
Autre figure décisive, évoquée dans Quand la beauté nous sauve, votre professeur de terminale, ancien manutentionnaire, contrebassiste, devenue agrégé de philosophie…
Tout à fait déterminante, oui. Il m’a totalement réveillé. J’ai adoré sa manière d’enseigner, la façon dont pour lui les concepts devaient avoir un impact existentiel. J’ai aussi beaucoup aimé sa sensibilité hégélienne selon laquelle il faut se réaliser dans l’existence, dépasser l’âme romantique qui se contente de sentir ce qu’elle vaut mais ne s’éprouve pas. Nous sommes ainsi devenus très amis, avons même enseigné ensemble en classe préparatoire de Sciences Po au lycée Lakanal de Sceaux. Lorsqu’il est mort il y a un an et demi, j’ai été le maître de cérémonie de son enterrement. Dans mon dernier roman, La joie, il y a une scène cruciale où le narrateur occupe cette fonction lors de l’enterrement de sa mère, qui en est directement inspirée. Ce fut donc une histoire très forte. Il était un professeur de l’oralité, et nous avons d’ailleurs beaucoup échangé autour de l’idée qu’un professeur de philosophie n’était pas quelqu’un qui doive nécessairement écrire des livres, mais dispense avant tout un enseignement oral. Je suis personnellement déchiré entre ces deux pôles, car j’adore mon métier d’enseignant mais j’ai également très envie d’écrire… Des romans notamment, j’ai pris beaucoup de plaisir à écrire La joie. Porter ainsi la philosophie à travers des personnages est une manière de philosopher autrement, que j’affectionne particulièrement.
Roman à part entière, La joie semble toucher un public en demande de contenu philosophique depuis plusieurs années…
Le succès n’était pas forcément évident dans mon cas car mon roman précédent date d’il y a douze ans. En France, les gens fonctionnent par cases, et j’occupe celle de « philosophe grand public pédagogue ». Du coup, je ne suis pas attendu sur une proposition authentiquement littéraire. Or, La joie est bien lu comme un roman et non comme un ouvrage strictement philosophique. Les français sont donc capables de s’émanciper des catégorisations excessives. Les auteurs ont peut-être trop tendance à anticiper les étiquettes et à vouloir s’y conformer. Le fait de se situer à la frontière des domaines constitués peut permettre d’assouplir les esprits, de perdre en rigidité. Ce faisant, on risque toutefois d’égarer les lecteurs ; les libraires en particulier ont du mal à me classer…
Si, à notre tour, nous voulons jouer des étiquettes, peut-on dire que La joie relève du conte philosophique ?
Oui, sans être non-plus tout à fait un roman à thèse, car celle qui s’y développe n’est pas si claire que cela. En réalité, il s’agit de créer un trouble plutôt que de proposer une thèse. C’est plus une manière de faire rencontrer l’épaisseur mystérieuse de la joie, de l’approcher sans l’éclairer tout à fait.
Votre approche de la forme romanesque consiste-t-elle à mettre en oeuvre l’esthétique hégélienne telle que vous la décrivez dans Quand la beauté nous sauve, c’est-à-dire de donner à « philosopher sans réfléchir » ?
Oui c’est cela. Pour La joie, j’avais plein de choses en tête, un grand nombre de références : Bergson, l’élan vital, Spinoza, Epicure, Clément Rosset chez les contemporains,… Tout mon travail a consisté à me débarrasser du didactisme afin que, sans être assénées, les idées se voient, se vivent, se ressentent à travers l’action, dans les moments de vie des personnages. J’aime beaucoup ce travail d’incarnation, que je pratique d’ailleurs de plus en plus en tant que professeur. Au lieu de répondre en termes argumentatifs à une question philosophique, il s’agit de mettre les élèves face à une situation existentielle, vécue, ou bien encore de faire référence à des tableaux, à des scènes de film, mais toujours en partant du concret. Au demeurant, il y avait déjà des saynètes alternant avec des passages didactiques dans Ceci n’est pas un manuel de philosophie, et Quand la beauté nous sauve empruntait également à la narration.
Cette entreprise d’incarnation d’une pensée ne présente-t-elle pas le risque de pécher par artificialité ?
C’est en effet une bonne question, et l’exercice fait prendre conscience de la prouesse qu’a représenté l’écriture des grands romans pourvus d’un fort contenu substantiel, tels que l’Etranger, la Religieuse, ou encore la Nausée. Pour ma part, j’ai beaucoup été aidé par le fait que la matière du livre est en grande partie autobiographique, mais la capacité à donner vie à des idées, constitue en effet le grand enjeu,le principal défi de l’écriture d’un tel roman.
Solaro, votre héros, est une sorte d’anti-Meursault ; du moins il se définit par opposition au personnage principal de L’étranger…
Il en est en effet une version joyeuse, et le roman une variation sur l’oeuvre d’Albert Camus. A la différence de Meursault, Solaro vit de nos jours à Paris et se caractérise par un affect inverse, celui de la joie précisément, et non plus de l’indifférence, il est le contraire d’un apathique. Ce roman est une réflexion sur la création, qui consiste le plus souvent en un décalage, car on ne crée jamais à partir de rien. On réinterprète toujours un existant. Ici, j’ai juste souligné ce dernier. Cela m’a d’ailleurs permis de découvrir une certaine inculture de la presse française. La plupart des journalistes n’ont pas su en effet déceler la référence à Camus, pourtant évidente. Il apparaissait même que certains ne l’avaient pas lu. A contrario, le niveau culturel m’a paru incroyablement plus élevé en Belgique, où les questions ont porté autant sur les aspects de structure littéraire que sur la dimension sociétale et psychologique du roman, en se fondant sur des lectures de Diderot, Sartre, Camus.
Parmi les références que vous citez, celle de Clément Rosset irrigue particulièrement le roman…
Il a en effet écrit La force majeure, un ouvrage décisif sur le thème de la joie, doté d’une puissance philosophique extrême, le type de livre dont on ne peut ressortir inchangé. Aussi mon personnage incarne-t-il la joie telle que Rosset la pense dans son livre, c’est-à-dire cette force majeure qui est là, sans raison d’être, qui ne se justifie pas, n’attend pas de conditions pour jaillir. C’est ce que j’exprime dans toute la première partie du livre, certaines scènes ayant directement pour fonction de rendre sensibles les concepts qu’il développe. Ensuite l’écriture a produit autre chose, qui ne relève plus de la pensée de Clément Rosset, le personnage dit autre chose. Celui-ci m’a d’ailleurs écrit pour me dire qu’il avait aimé le début du roman, mais, en toute logique, moins adhéré à la seconde.
Un point sur lequel vous insistez est par ailleurs la distinction à bien opérer entre joie et bonheur…
Je voulais en effet réagir à l’injonction au bonheur qui marque notre époque et que l’on peut trouver lassante. Le bonheur est un état durable de satisfaction, relatif à notre existence en général. Or, un certain réalisme indique que cet état n’est pas atteignable. Notre condition mortelle, notre finitude, l’influence des passions, les violences politiques, tout cela nous en empêche. En revanche, la joie est supérieure au bonheur en ce qu’elle s’accommode de tout cela, voire même se nourrit des raisons qui précisément entravent le bonheur. On peut connaître la joie dans la souffrance, dans la désillusion, intensifiée justement par les raisons qui nous rendent le bonheur impossible. Si un attentat est possible à tout moment, la bière que l’on boit en terrasse n’en est que meilleure. C’est alors une joie, inquiète, mais une joie tout de même, et non du bonheur. L’idée était aussi de réagir en tant que philosophe aux commandes récurrentes que je reçois sur le thème du bonheur. Le bonheur en entreprise, le bonheur au quotidien,… qui constituent l’essentiel des demandes de conférences qui me sont adressées. C’est le signe d’une époque malheureuse. La joie elle, est possible, contrairement au bonheur. Il y a aussi l’idée connexe dans le roman que l’espoir peut être le plus grand ennemi du bonheur…
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Romans
La joie, éditions Guillaume Allary, 2015
Les infidèles, Flammarion, 2003
Descente, Flammarion, 1999
Essais
Quand la beauté nous sauve, Robert Laffont, 2013
Ceci n’est pas un manuel de philosophie, Flammarion, 2010
Les philosophes sur le divan, Flammarion, 2008
Une semaine de philosophie, Flammarion, 2006
Bandes dessinées (avec Jul)
Platon Lagaffe, Dargaud, 2013
La planète des sages, Dargaud, 2011
Propos recueillis par Hugues Simard